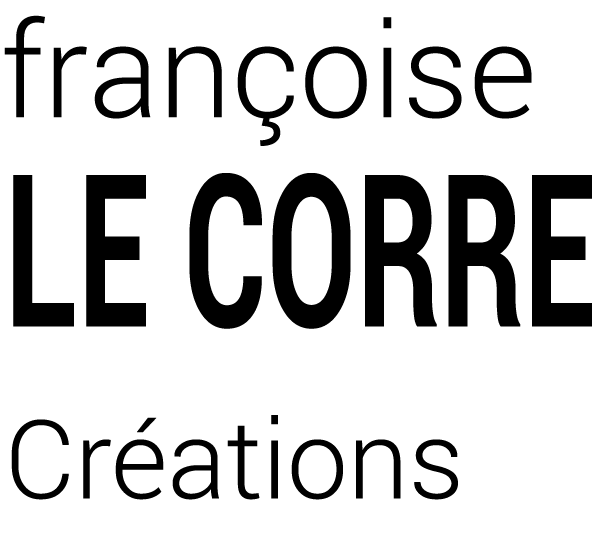A quoi ça tient ? Autour d’une oeuvre ou les cercles concentriques.
à propos de Nicolas de Staël (1914-1955).
Autour des œuvres, d’une œuvre ou les cercles concentriques.
A propos de Nicolas de Staël (1914-1955).
« Toute ma vie j’ai eu besoin de penser peinture,
de voir des tableaux,
de faire de la peinture pour me libérer de toutes les impressions,
de toutes les sensations,
toutes les inquiétudes
auxquelles je n’ai jamais trouvé d’autres issues que la peinture.»
Nicolas de Staël [1]
Trouver d’autres issues, écrivait Nicolas de Staël.
Quelles impasses alors, quels murs au tréfonds ?
Un fil d’Ariane toutefois : la peinture.
Et pourtant, ce sera un saut dans le vide en 1955,
quelque chose cède, cesse ou se réalise irrémédiablement.
«A quoi ça tient» ? questionne l’adage.
A quoi ça tient cette pratique vitale pour l’artiste,
celle par laquelle il affecte son temps à traduire et transposer,
à préciser ce qui le traverse et vice versa,
à placer ainsi hors de lui, par ses créations, un invisible qui fait heurts,
insiste et demande à trouver passages.
Quel désir et quel dire, dans cette rencontre avec l’immanence, dans cette manière d’incarner.
Serait-ce une affaire d’élaboration du sujet, dans ce face à face avec ce qui se révèle d’œuvre en œuvre, par rassemblements, digressions et associations.
Chaque tentative : comme un chemin de traverse, à moins qu’il ne soit de crête celui-là.
Ouvrage de création qui fait voisiner les débris de la casse et les aspirations.
La cohérence des incohérences fait apparaître une lisibilité, émanant d’une archéologie aussi personnelle que filiale. Le médium soutient alors les essors apolliniens et le vortex dionysiaque, par inscription dans la matière.
Serait-ce cela prendre corps ?
«ex-sistence», articulait Jacques Lacan.
Et puis à quoi ça tient qu’une œuvre nous retourne, une première fois à la rencontre, et puis, à chaque fois de la retrouvaille.
Quelles strates en concordances ?
A quoi ça tient, qu’une autre ne parvienne pas à la coordination avec notre attention, qu’elle n’engendre qu’ennuie, désolation, détournement ou infortune à l’entendement.
Qu’est ce qui de la psyché et du vécu s’entrelacent, se noue sur la surface picturale, incarnant marques et empreintes. A quoi ça tient que la vie et l’œuvre se conjuguent et s’articulent, forcément marquées l’une par l’autre, pour quel chant des possibles ?
D’émission en réception, s’instaure une écoute entre découverte et discernement.
Une sorte d’entre les lignes : le domaine de la Nuance,
Une sorte de « mi- dire » peut-être bien.
Affaire de séances, de séquences : un hors champs opérant aux surfaces circonscrites.
A quoi ça tient un tel regard,
celui que Nicolas de Staël pose sur son environnement depuis son intériorité.
Celle là qui dicte, demande et acte,
à en surprendre celui qui œuvre et celui qui reçoit.
Chants d’associations intiment intriquées au vécu : corps et âme.
Nicolas de Staël, est né Baron Nikolaï Vladimirovitch Staël von Holstein, en 1913 à Saint Pétersbourg, devenue Petrograd. Immigration en 1917, question de survie, mais orphelin à 6 ans.
Les placements et déploiements : Bruxelles, Paris, Afrique du nord, Italie et retour,
précisions faites : il sera peintre.
Les amours, les enfants, les deuils,
Les manques, les quêtes, les comblements.
Ménerbes, Agrigente en Sicile,
et le sud encore,
jusqu’au fatidique 16 mars 1955,
où il se jette du balcon de la maison d’Antibes.
Passage à l’acte dit-on,
se donner la mort,
à quoi ça tient, ou pas.
A quoi ça tient ce précipité, quels précipices, ce sans issue, ou cette issue par absolue rupture.
Quel franchissement, pour quels obstacles ?
A quoi ça tient cette écriture singulière, jamais vue avant lui, immédiatement identifiable.
A quoi ça tient un tel continuum dans l’ouvrage,
cet acquiescement sans détournement aucun, tant que la vie opère,
cet éternel retour du centre coronaire de la psyché vers le medium élu par celui qui œuvre;
ces matières et manières qui permettront de transcrire, de dire, voire de quitter ce qui se trame et fait texture,
comme paroles et silences opèrent en analyse.
Rejoindre alors l’impérieuse nécessité, que le peintre Vassili Kandinsky nommait : « intérieure »,cet imperceptible qui façonne
On pourrait déposer-là en citation relevée dans l’ouvrage d’Eugen Herrigel, « Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc ». A propos du Zen, il explique : « les organes habituels de compréhension ne peuvent le saisir car il n’est pas spéculation mais expérience du fond insondable de l’être et que l’entendement ne peut concevoir.
On le sait en tant qu’on l’ignore. »
Et la pratique artistique peut bel et bien relever de ce propos : « on le sait en tant qu’on l’ignore ».
la cure analytique, en diverses parts s’y pétri aussi :
élans et retours qui inscrivent dans la durée,
reliés à des rhizomes, des résonances: du sous-jacent, à la résurgence.
Une exploration, d’entropie et de néguentropie, qui embarque dans une navigation sans cartes,
juste sous constellations,
à décrypter,
reliée à un inconnu sachant,
qui ne demande qu’à se déployer pour nous laisser en vie,
soutenir le sujet qui peine
et traverser en percée le mur de l’impasse.
A quels fils conducteurs sont reliés ceux qui : chaque jour,
une vie durant,
s’aventurent dans l’exploration de ce qu’ils ignorent, tout en le subodorant.
Ceux qui cherchent sans savoir,
osant les tentatives pour entrer en passages,
un autrement, en flux et lux occurrents.
Ceux qui font sillon à ce qui les anime : qui à la fois les portent et pourrait tout autant les détruire ;
Ce qui les transporte vers l’advenir de la prochaine mise en œuvre,
ce qui se met en mouvement,
ce qui se fait attendre, entendre, se délie sous l’esquisse : rendant visible, audible.
Perceptibles traces qui se montrent, pour se faire suivre :
là où il y avait : rien hors de soi,
Quelque chose apparaît.
Nicolas de Staël a beaucoup peint, mais détruit beaucoup également.
Le singulier de son écriture est dans sa transcription par l’épure, l’effleurement des pleins par les marges,
les contrastes entre réserves et vibrations, les empâtements comme des écorces, puis la matière fluidifiée des dernières œuvres. Des constructions par touches juxtaposés, comme des tessellesimbriquées faisant mur, surfaces et ouvertures.
A quoi fait-elle jour cette façon de peindre : quels sont les titres, les matières et les manières qui attestent.
Une écriture par le fragment, le recouvrement et les interstices,
pour un tout plus vaste que le sujet lui-même.
Une émergence qui lui est propre.
Une inauguration, par un modus operandi aussi synthétique que vigoureux,
Aussi épais que vibrant, aussi délimité qu’ouvert.
Un diapason du Là.
Une lucarne, un miroir : un vis-à-vis en pleine présence à ce qui est.
L’éternelle tentative de rencontres entre élaborations et circulations.
Une autorisation qui se joue entre liens, franchissements et barrières.
Toujours une mise en oeuvre qui transmue les tensions en élans.
250 tableaux peints entre 1953 et 1954,
mais en 1955 : passage à l’acte
laissant cette œuvre à notre considération.
« Attention, percevoir nécessite de s’engager », pressent l’artiste Antoni Muntadas [2].
« Per aspera ad astra » [3], propose la locution.
Si seulement
flc juin 2021
[1] Écrit à l’occasion de son exposition à New York en février 1953, cité dans l’article « l’œuvre aventurière de Nicolas de Staël » Henri Maldiney (référence à compléter)
[2] Artiste multimédia, né en 1942 à Barcelone.
[3] Par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles.